A short story that takes place in Siwa published by Louis Reybaud in "Journal de Toulouse - Politique et Litteraire" in October 1852.
Marie Roch Louis Reybaud (15 August 1799 – 26 or 28 October 1879) was a French writer, political economist and politician. He was born in Marseille.
Nouvelles de Louis Reybaud.
LES AVENTURES D'UN FIFRE.
Le souterrain.
La soixante-neuvième demi-brigade était citée en Égypte pour son corps de musique, l'un des mieux exercés de l'armée expéditionnaire. Sous la république, cette branche de l'art n'était pas cultivée comme elle l'est aujourd'hui où chaque régiment possède un véritable orchestre, armé d'instruments à vent harmonieux et de cuivres sonores. Quand les clarinettes ne jouaient pas trop faux et que la grosse caisse battait en mesure, on croyait avoir des artistes parfaits.
Un bon fifre surtout était regardé comme la dernière expression de la musique militaire, et c'était à qui se procurerait ce phénix rare et
recherché. Sous ce rapport, la soixante-neuvième ne laissait rien à
désirer: son fifre passait pour l'une des merveilles du genre. Dans les sérénades de la place de L'Ezbékié, où logeait l'état-major, c'était lui qui exécutait, les solo, et il s'en acquittait avec un talent qui lui valut plus d'un illustre suffrage. Quand l'entrepreneur du Tivoli
égyptien voulait organiser une fête dansante, il commençait par
s'assurer la collaboration du fifre de la soixante-neuvième. Plus d'une fois, Bonaparte lui-même le fit appeler pour charmer les loisirs de la dame de ses pensées. Le fifre, il faut le dire, méritait ces honneurs.
Ce n'était pas un artiste ordinaire, exécutant machinalement quelques vieux airs sur le mode aigu. Il avait un répertoire varié et se piquait
de tenir la demi-brigade à la hauteur des partitions récentes. La Marche des Tartares de Kreutzer, les choeurs de Paul et Virginie lui
étaient familiers. Quand il touchait à la musique ancienne, c'était en
connaisseur. Il demandait des motifs à l'Orphée et à l'Alceste de
Gluck, à la Didon de Puccini, aux bons opéras de Lulli et de Rameau, et ne se privait pas de mettre le Devin du village en variations. Jamais fifre ne fut mieux doué par la nature.
On le connaissait dans la demi-brigade sous le nom de Roquet. Il est possible que ce ne fût pas là son nom véritable; mais personne ne lui en donnait d'autre. C'était un enfant de troupe qui avait été élevé dans la chambrée, petit de taille et peut-être un peu noué: de là lui était venu son sobriquet. Roquet avait fait les premières campagnes du Rhin comme l'enfant de là soixante-neuvième. Quand il eut douze ans, le major lui fit cadeau d'un fifre, et, au bout de huit jours, il en tirait déjà des sons satisfaisants. La demi-brigade rendit justice à cette vocation, précoce, et, après un mois d'exercice, Roquet était incorporé comme second fifre. A quinze ans, il passa premier fifre; c'était son bâton, de maréchal. Dès ce moment l'amour de son art le domina tout entier.
Dans, les premiers jours qui suivirent l'occupation du Caire, l'aspect
de la ville et des environs défraya la curiosité du soldat. Ce qui
surtout attira les visiteurs, ce furent les colosses en pierre dont
Bonaparte avait évoqué le souvenir, au moment de la bataille décisive qui lui livra l'Égypte. Presque tous les corps allèrent à leur tour contempler ces pyramides assises sur les confins du désert et déjà atteintes par les envahissements des sables. Leur masse imposante semblait planer sur ces solitudes et marquer la place où fut cette Memphis, que dévastèrent Cambyse et Amrou. Tout cet espace est aujourd'hui frappé de stérilité et en proie à la dévastation. Quelques bouquets de palmiers et d'acacias épineux (l'acanthe des Égyptiens) varient seuls la monotonie et la tristesse du paysage. Sur cette lande, aujourd'hui si nue, s'éleva pourtant l'une des plus grandes capitales du monde ancien, et là, où quelques villageois épars, végètent à peine, vivaient autrefois deux cent mille âmes dans une enceinte couverte de palais. Ainsi disparaissent les villes comme les peuples; le temps emporte jusqu'aux vestiges des civilisations qui ont accompli leur
tâche.
Au delà de Memphis et en remontant le Nil se trouve, à la limite même de la vieille capitale, une seconde nécropole non moins curieuse que celle des grandes pyramides de Gizeh. On la nomme indifféremment la Plaine des Momies ou la Plaine de Sakkarah. Gizeh formait le camp des morts du côté du nord, Sakkarah du côté du midi. D'autres pyramides moins élevées, mais plus nombreuses, attestent cette destination. Aucun lieu n'offre plus d'intérêt. C'est de là ou des hypogées de la haute Égypte
que l'on a tiré ces momies, qui sont devenues l'objet d'un commerce en Europe. Commerce singulier, qui peuple nos musées de corps desséchés sous leurs bandelettes, et qui n'entrait probablement pas dans les calculs de ceux qui se firent embaumer de la sorte! Aujourd'hui, grâce à cet esprit de conservation, de graves hiérophantes, morts, il y a quatre mille ans, dans la vallée du Nil, se trouvent transportés, sur les bords de la Seine, et trouvent dans nos musées une place d'honneur à laquelle ils ne songeaient guère de leur vivant.
La plaine de Sakkarah a été, dans tous les temps, le théâtre de
spéculations étranges. Une masse énorme de puits, de souterrains, de
pyramides, de cryptes, s'y offre aux profanateurs de sépultures. L'usage
grec, qui en cela, dit-on, n'était que la suite d'un usage égyptien,
voulait que l'on mît dans la bouche de chaque mort une pièce de monnaie,
représentant l'obole due à Charon, le cocher des enfers. Les Arabes, qui
ont peu de respect pour les traditions mythologiques, ont découvert, il
y a longtemps, cette particularité, et l'on trouve aujourd'hui dans ces
champs de repos peu de cadavres qui n'aient la mâchoire-brisée. Un autre
trafic est celui des oiseaux sacrés, auxquels, était consacré un immense
puits qui l'on connaît aujourd'hui encore sous le nom de puits des
oiseaux. C'est de là que nous viennent ces ibis empaillés qui font
l'honneur des riches collections de l'Angleterre et du continent. La
plaine de Sakkarah se trouve ainsi parsemée tout entière d'ouvertures
plus ou moins profondes qui, les unes horizontales, les autres
perpendiculaires, donnent accès vers des galeries souterraines
communiquant entre elles.
Quoique cette plaine fût située à six lieues du Caire, cependant elle
était l'objet d'excursions nombreuses. Le corps de musique de la
soixante-neuvième eut l'occasion, de s'y rendre en faisant la conduite
au général Desaix qui s'embarqua sur le Nil pour rejoindre sa division
alors en marche vers la haute Égypte. Plusieurs barques ou djermes
avaient été employées à ce transport, et l'une d'elles portait
l'orchestre flottant. Roquet en était l'âme, et jamais il ne montra tant
de verve. Ce large fleuve sur lequel l'escadrille glissait, ces rives
couvertes de beaux sycomores, cette longue suite d'îles qui forment un
archipel de verdure, tout contribuait à exciter l'enthousiasme musical
de l'artiste: il se surpassa. Les ombres des pharaons Khéops et
Mycérinus durent être charmées par des variations sur la Marseillaise
et le Chant du départ, comme jamais fifre humain n'en avait cadencé.
Le trajet fut ainsi abrégé, et grâce à un vent favorable, trois heures
après le départ du Caire, on se trouvait en face de la plaine de
Sakkarah. Là s'arrêtait l'itinéraire du corps de musique. Desaix
poursuivit seul sa route vers la haute Égypte. Quant à l'escorte
instrumentale, elle voulut avant que de reprendre le chemin du Caire,
jeter un coup d'oeil sur les antiquités de cette nécropole. On débarqua
donc les artistes sur le rivage en leur accordant une heure pour
satisfaire leur curiosité. Ils se répandirent joyeusement dans la plaine
couverte de pyramides ruinées, les unes en brique, les autres en
grès-brèche, celles-ci de trois cents pieds de haut, celles-là dépassant
à peine la taille d'un homme. Il faut croire que c'était là, chez les
Égyptiens, une manière de mesurer le rang du défunt. Les pyramides des
Pharaons, souverains de la contrée, avaient quatre cents pieds de
hauteur; les pyramides de leurs sujets devaient être d'une élévation
moindre et proportionnée à leur importance. Après les rois venaient les
prêtres, puis les guerriers, puis les artistes, ensuite les autres
classes, dans l'ordre de leur fortune et de leur condition. Ceux qui ne
pouvaient pas aspirer aux honneurs de la pyramide se contentaient d'une
place dans les caveaux souterrains où les cadavres embaumés étaient
rangés contre la muraille. A de certaines époques de l'année on
descendait dans ces catacombes, et la génération vivante y exécutait une
procession aux flambeaux au milieu de ces générations mortes.
On s'est souvent demandé si cet embaumement, universel chez les
Égyptiens, ne prenait sa source que dans une pratique religieuse, ou
s'il fallait en rapporter l'origine à quelque mesure d'hygiène. Le fait
est qu'aujourd'hui, dans cette vallée autrefois célèbre par sa
salubrité, règne un fléau qui semble y avoir établi son siège. La peste,
avec les caractères qu'on lui connaît, est née en Égypte, et c'est
toujours du littoral égyptien qu'elle rayonne sur le reste de l'Orient.
Dans aucun autre pays du monde on ne retrouve un mal semblable avec les
accidents qui le distinguent. Or qui nous dit que l'embaumement des
corps n'avait pas été déterminé autrefois par les inconvénients de
l'inhumation dans un sol d'alluvion, et ne se pourrait-il pas que la
peste fût issue de la désuétude de cette méthode? Les Égyptiens étaient
un peuple grave, et observateur; ils ne faisaient rien sans réflexion,
sans dessein, sans motif. Dans ce cas, les moyens préventifs de la peste
se trouveraient principalement dans un autre système d'inhumation que
celui qui est aujourd'hui en vigueur en Orient. Si le procédé
d'embaumement sur une grande échelle est impossible dans l'état de
civilisation de ces contrées, on pourrait avoir recours à des moyens
plus simples et moins coûteux. L'incinération païenne avait cela
d'avantageux quelle faisait disparaître toutes les exhalaisons
délétères; son seul inconvénient était d'enlever le corps du délit, en
cas de crime.
Qu'on nous pardonne ce hors-d'oeuvre! Il est à croire qu'aucune de ces
réflexions ne fut suggérée, par l'aspect de la nécropole, aux
clarinettes, aux chapeaux chinois et aux cymbales de la
soixante-neuvième. Ils visitèrent le champ du repos en véritables
profanes, gravirent les pyramides, cherchèrent à pénétrer dans les
souterrains accessibles, d'où ils enlevèrent quelques débris de momies,
des bandelettes, des plumes d'oiseaux et ces petites poteries rouges que
l'on trouve en abondance dans toutes les tombes anciennes. Rien de
particulier n'avait signalé cette petite maraude, quand, au coin d'un
tertre que surmontaient quelques acacias, un cri se fit entendre.
C'était le fifre Roquet, qui venait de s'engloutir dans un puits dont un
large câprier masquait l'ouverture. Le malheureux avait, mis le pied sur
la plante rampante, croyant qu'elle couvrait un terrain solide, et il
s'était abîmé dans un gouffre de quarante pieds de profondeur. A la
première alerte tous ses compagnons accoururent. Avec le tranchant du
sabre on eut bien vite débarrassé l'ouverture du feuillage parasite qui
l'obstruait, et l'on reconnut un orifice de six pieds de circonférence,
destiné évidemment à servir de soupirail à ces catacombes. Une obscurité
profonde empêchait de rien distinguer au fond du puits; mais il était
facile d'entendre des gémissements plaintifs qui prouvaient que le
pauvre fifre s'était blessé dans sa chute.
On l'interpella à diverses reprises, sans obtenir de réponse. Enfin, il
parvint à s'expliquer. Grâce à divers obstacles qui avaient amorti le
coup, Roquet en était quitte pour quelques contusions. Remis de cette
terrible secousse, il put se lever et s'assurer de l'état des lieux. En
tâtant les parois de sa prison, il s'assura qu'elle était murée de
toutes parts et qu'elle n'offrait aucune issue. Le seul moyen de sortir
de ce cachot était donc de regagner l'ouverture par laquelle il avait
été précipité. Mais comment tenter cette ascension périlleuse? On essaya
divers expédients. En premier lieu le fifre chercha à reconnaître s'il
ne serait pas possible de remonter vers le soupirail à l'aide des
aspérités et des saillies que pouvaient offrir les murs du souterrain.
Tous ses efforts furent vains: dans la partie inférieure les parois
étaient lisses et ressemblaient à celles de la citerne où Joseph fut
jeté par ses frères; à peine put-il s'élever à une hauteur, de deux ou
trois pieds; au delà les points d'appui lui manquaient: On comprit dès
lors que son salut ne devait venir que d'en haut. Les imaginations se
donnèrent carrière. On n'avait pas de cordes, mais en ajoutant les uns
aux autres les mouchoirs des musiciens on parvint à en confectionner une
qui fut descendue, dans le souterrain. Elle n'arrivait pas au fond;
cependant, à force d'élans, Roquet parvint à en saisir l'extrémité, et
il s'y suspendit avec l'énergie d'un homme à bout de ressources. Ses
compagnons, le sentant cramponné, commencèrent à tirer à eux la corde
artificielle, avec toutes sortes de précautions; mais à peine le pauvre
fifre se trouvait-il à quinze pieds du sol, que le lien se rompit et le
fit rouler de nouveau au fond de son caveau, plus meurtri et plus
disloqué qu'auparavant. Impossible de renouveler la même expérience aux
dépens des membres et de la vie du prisonnier. Les barques étaient à une
demi-lieue de là; quatre musiciens se détachèrent pour aller chercher
l'un de ces cordages en sparterie qui font partie de l'équipement de
toute marine arabe; les autres restèrent sur les lieux en rassurant le
pauvre fifre contre l'abandon et l'exhortant à la patience.
Roquet commençait à voir clair dans son cachot. On sait quelle lucidité
acquiert la vue à mesure qu'elle s'habitue aux ténèbres. Ainsi, peu à
peu, il apercevait une foule d'objets qui, jusque-là, lui avaient
échappé. Le souterrain était plus vaste qu'il ne l'avait cru d'abord; sa
forme était celle d'une citerne dont le cerveau se serait arrondi en
voûte. Elle ne semblait pas avoir servi à des inhumations, car aucun
débris humain ne jonchait le sol. Tous les revêtements étaient achevés
avec un soin infini, et rien n'avait été épargné pour en faire une
habitation convenable; seulement les hôtes y maquaient On n'y remarquait
pas même les traces du passage de flambeaux, qui sont le caractère
distinctif de tous les hypogées et de toutes les cryptes de l'Égypte. La
visite aux morts, dans des jours solennels, était de cérémonial strict
dans l'ancienne religion des hiérophantes; et telle est la paissance de
conservation de ces souterrains, que la fumée, laissée par les torches,
il y a plus de trois mille ans, y subsiste encore.
Cependant, à force de fureter dans les recoins de sa prison, Roquet
finit par découvrir une issue entièrement masquée par un retour de la
muraille.. C'était un couloir, étroit dans lequel; tout grêle qu'il
était, il ne put s'engager sans effort.
Une crainte instinctive le retenait d'ailleurs: il craignait de
rencontrer de nouvelles chausse-trapes et de descendre ainsi d'étage en
étage, jusqu'aux entrailles de la terre. Toutefois la curiosité
l'emporta. En s'effaçant un peu, il parvint à franchir le corridor, qui
s'élargissait graduellement, et arriva ainsi dans une longue galerie
qu'éclairaient des soupiraux placés de distance en distance et disposés
de la même manière que celui par lequel il avait fait la culbute. Cette
galerie était peuplée: deux longues files de momies adossées aux murs
semblaient diriger sur les visiteurs importuns des yeux fixes et
sévères. Roquet n'était pas poltron; il allait bravement au feu; le
sifflement des balles, le bruit du canon ne l'intimidaient pas. Pourtant
il eut peur. La mort ne lui était jamais apparue sous cet aspect, avec
ce cortège de représentants. Seul vivant au milieu de ces cadavres, il
se peupla l'esprit de fantômes, crut voir leurs yeux s'animer; leurs
têtes se mouvoir. Le silence même de ces catacombes l'épouvantait; il
regrettait les risques des champs de bataille.
On sait combien la peur est ingénieuse. Roquet eut recours à tous les
expédients qu'elle suggère. Il toussa, se moucha, se parla tout haut. Il
appela par leurs noms ses camarades du corps de musique. Sa voix ne
parvint pas jusqu'à eux, et ils ne purent lui répondre. Il voulait alors
revenir sur ses pas, mais une force presque invincible semblait le tenir
enchaîné; on eût dit qu'il ne voulait pas donner à ces momies le
spectacle de sa fuite et qu'il craignait d'être poursuivi par leurs
ricanements. Alors une idée lui vint: il avait son fifre en poche, il se
résolut à exécuter une sérénade d'un style français en l'honneur de ces
vénérables sujets des Pharaons. Ce petit concert avait le double
avantage de le distraire de ses frayeurs et de mettre ses camarades sur
la trace de son Odyssée souterraine. Il préluda donc par la _Marche des
Tartares_; et un certain perlé, résultat de l'émotion intérieure, donna
à son exécution des qualités toutes nouvelles. On l'avait entendu d'en
haut, on le suivait: le fifre indiquait sa position. Roquet, plus
rassuré, se surpassa, il fit des merveilles; il épuisa les richesses de
son répertoire, depuis le Roi Dagobert jusqu'au Charon t'appelle,
célèbre choeur de l'_Alceste_, de Gluck. Vers les dernières modulations
de cet air sinistre il lui sembla que les momies de la galerie
s'agitaient; et, s'effrayant du succès de son évocation, il commença à
jeter autour de lui des regards moins assurés. Peu à peu il s'était
produit, en effet, comme une révolution parmi ces cadavres placés dans
l'ombre la plus reculée; et, au moment où le pauvre fifre répondait à
l'appel de ses amis du dehors qui arrivaient avec de nouveaux moyens de
sauvetage, des yeux vivants se fixèrent sur lui, deux bras nerveux le
saisirent et l'entraînèrent dans un souterrain contigu où ne pénétrait
pas la moindre clarté.
Dès lors, ce fut vainement que du dehors on appela Roquet, Roquet ne
répondit plus. Deux amis dévoués, une clarinette et un triangle, se
firent descendre par une corde dans le souterrain, le parcoururent dans
tous les sens, visitèrent les moindres détours: Ils ne purent rien
découvrir. Un instant, dans la direction d'un caveau sombre, ils crurent
entendre quelques mesures de l'air favori de la victime: _Non! non!
Colette n'est point trompeuse_ du Devin; ils marchèrent de ce côté,
armés de grandes torches, cherchèrent avec la plus minutieuse attention,
redemandèrent Roquet à ce labyrinthe sombre. Soins inutiles! Roquet
avait disparu.
II
Le désert.
Voici l'explication de l'enlèvement du fifre Roquet. Longtemps l'armée
d'Égypte en fit l'objet de versions surnaturelles.
Le triangle et la clarinette, descendus pour le secourir, mêlèrent à
leur récit un peu de fantasmagorie, afin de se donner un certain relief
de courage. L'exagération ne gâte rien au dévouement. Le triangle
prétendait avoir aperçu une bande de démons qui avaient attiré le fifre
dans un gouffre où il s'était abîmé avec eux. La clarinette, esprit
fort, attribuait sa disparition à l'une de ces portes secrètes qui se
ferment d'elles-mêmes sur les visiteurs imprudents. Mais tout le corps
de musique et l'armée s'accordaient à dire que Roquet, la perle des
fifres, était mort. La soixante-neuvième demi-brigade lui donna un
remplaçant.
On se trompait, pourtant; Roquet vivait encore. On a vu que les Arabes
fréquentent les tombeaux de la plaine de Sakkarah; personne mieux qu'eux
n'en connaît la topographie souterraine: Presque toutes ces galeries se
communiquant entre elles et forment un labyrinthe mystérieux, dont les
détours et les ouvertures sont familiers aux tribus nomades de la Libye.
Cette nécropole a plusieurs issues vers le désert; et, quand les
Bédouins prévoient que le simoun va souffler, ils accourent avec leurs
tentes et se décident à vivre pendant quelques jours en troglodytes, au
sein de ces catacombes. Le hasard avait voulu que l'une de ces peuplades
habitât ces souterrains quand Roquet s'y laissa choir. Si l'artiste
n'eût pas voulu faire preuve de ses talents sur le fifre et charmer les
momies d'alentour, il est probable qu'on ne se fût pas aperçu de sa
présence; mais les sons de l'instrument attirèrent les naturels, qui
s'emparèrent du malheureux musicien et le dérobèrent facilement aux
recherches. Roquet n'était donc pas mort, mais il se trouvait à la merci
des Arabes, ce qui n'était guère plus récréatif. Le fanatisme est grand
parmi ces tribus, et, au moment où cette aventure arriva, la terreur de
nos armes ne les contenait pas encore. Aussi leur; première pensée
fut-elle pour les moyens violents. Ils voulaient immoler le prisonnier,
les uns par préjugé religieux, les autres par précaution. La jeunesse de
Roquet le sauva. Les femmes de la tribu intercédèrent pour lui: il fut
épargné. Le cheik l'attacha à son service, et le pauvre fifre eut
bientôt, à se défendre de ses bontés non moins dangereuses que ses
rigueurs. La tribu entre les mains de laquelle il était, tombé était
celle des Hennadis, l'une des plus puissantes du désert libyque. Une
fraction seulement avait poussé une reconnaissance vers le pays cultivé;
le reste campait à deux journées de chemin du Nil, dans la vallée du
Fleuve sans eau. Quand la nuit fut venue, le cheik abandonna la
nécropole souterraine avec ses gens et ses femmes, et prit la route du
grand désert.
Qu'on juge des inquiétudes de notre héros. Livré à des destinées
inconnues, à la merci des bandits, dont il connaissait les habitudes
vagabondes, qu'allait-il devenir? La vie lui restait; mais c'était une
vie d'esclave, errante, en butte à toutes sortes de privations. Tant que
dura l'étape nocturne, le sentiment de sa situation s'effaça pour ainsi
dire; mais quand le jour parut, quel spectacle s'offrit à lui!... Il
était au milieu d'une centaine de Bédouins armés de piques, de sabres et
de fusils: de quelque côté qu'il jetât les yeux, il ne voyait que des
figures peu rassurantes, enveloppées de burnous blancs. On eût dit une
troupe de fantômes. A ses côtés, et montées sur des ânes, cheminaient
les femmes, vêtues d'étoffes brunes. Quelques chameaux portant des
provisions terminaient la caravane, et on l'avait juché sur le cou de
l'un de ces animaux. Pauvre fifre de la soixante-neuvième! Le mouvement
de la bête lui occasionnait des nausées semblables au mal de mer, tant
il est vrai que le chameau justifie de toutes les manières son surnom de
vaisseau du désert. Puis, quelle perspective! On était en pleine
Libye... Les ondulations du sable variaient seules la monotonie de cet
horizon qui avait la couleur de l'ocre; le soleil montait dans le ciel
et commençait à chauffer l'arène qui étincelait sous ses rayons. La
chaleur était telle, qu'il eût suffi d'enfoncer un oeuf dans le sable
pour le voir se cuire à l'instant. Point d'eau, point de gazon, point
d'arbres. Seulement quelques palmiers grêles de loin en loin et servant
comme de jalons dans ces solitudes. Roquet était anéanti. Cette
atmosphère le suffoquait, ce sol jaunâtre lui envoyait des
réverbérations insupportables, son chameau même lui était odieux. Trois
fois il se laissa tomber volontairement, trois fois on le ramassa à
demi-mort. Enfin, à l'aide d'une corde, on le fixa sur sa bête comme un
véritable patient.
Au premier puits on fit une halte: il y avait là quelque ombre et un peu
de fraîcheur. Un grand figuier et trois sycomores avaient pris racine
dans ce lieu sauvage, et y disputaient aux hommes le petit nombre de
gouttes que contenait cette coupe d'eau. On détacha Roquet de dessus sa
fatigante monture: on le convia au repas commun, qui se composait de
dattes et de galettes desséchées. Ce que c'est que la nature humaine!
Dès que le fifre put respirer plus à l'aise, l'appétit lui revint, et il
fit à l'ordinaire des Bédouins plus d'honneur qu'on n'aurait dû s'y
attendre. Ce retour fut compris par le cheik, qui témoigna dès lors plus
d'égard à son prisonnier. On lui épargna le supplice que causent les
allures du chameau à ceux qui n'y sont pas habitués; on lui donna à
monter un fort joli cheval. Son habit de drap, dont les boutons de métal
tentaient la cupidité des Arabes, son chapeau lui furent enlevés mais,
en revanche, on l'affubla d'un excellent burnous, qui le défendait
contre les ardeurs du soleil, et, au besoin, lui garantissait le visage.
Dans l'une des poches du frac d'uniforme se trouvait son fifre, qu'il
défendit bravement contre ses détrousseurs. Un Bédouin s'en était emparé
et l'examinait avec curiosité. Roquet se jeta sur lui pour le reprendre,
et une querelle allait s'ensuivre, quand le cheik intervint. Il se fit
remettre l'objet du débat, et parut fort intrigué de sa forme. Le bois
de l'instrument ne séduisait personne, mais il n'en était pas de même
d'une petite clef en cuivre étincelant comme l'or. Roquet résolut de
vider le différend par une épreuve décisive. Il donna à entendre au
cheik qu'il allait montrer à la tribu l'usage de cet ustensile étrange
pour elle; et quand il s'en trouva de nouveau nanti, il l'emboucha et
préluda par une des mélodies les plus expressives: _J'ai perdu mon
Eurydice_, de l'_Orphée_ de Gluck. Ces sons imprévus produisirent
l'effet d'un coup de théâtre. A l'instant même, l'artiste fut entouré
par toute la caravane; on l'excitait de la voix, on l'encourageait du
geste. Tous les yeux étaient devenus bienveillants, toutes les
physionomies riantes. Tantôt la surprise se manifestait par un silence
profond, tantôt l'admiration éclatait dans une explosion bruyante.
Roquet avait gagné sa cause: il comprit que son fifre était désormais
une puissance.
Cependant, le signal du départ ayant été donné, on s'enfonça de nouveau
dans la Libye. Cet océan de sables semblait n'avoir pas de fin. Aucun
être vivant n'en animait l'aspect, si ce n'est, de temps à autre, un
troupeau de gazelles qui fuyaient en bondissant, ou quelque autruche
ouvrant ses ailes, comme un navire ses voiles, pour se dérober plus vite
aux regards. Aux journées brûlantes succédaient des nuits glaciales; la
rosée baignait les tentes, traversait les burnous les plus épais. La
moindre imprudence était punie par des douleurs cuisantes dans les yeux,
souvent même: par l'ophthalmie. C'était là de cruelles épreuves pour un
Européen; notre héros les supporta avec courage. Enfin, après quatre
jours de marche, on rejoignit le gros de la tribu, qui se composait de
quatre cents tentes. Elle campait alors dans un petit vallon tapissé de
broussailles et ombragé par un bouquet d'arbres. Une source coulait de
la base du rocher et fournissait une eau potable, quoiqu'un peu
saumâtre. Ce vallon était situé au-dessus des lacs de Natron et dans le
voisinage des monastères cophtes, qui, de temps immémorial, occupent
cette zone du désert. Quand la tribu manquait d'eau ou de vivres, elle
poussait une reconnaissance vers l'asile de ces religieux, qui
préféraient lui payer un tribut forcé plutôt que de s'exposer à sa
vengeance. La tribu était: d'ailleurs l'une des plus puissantes de la
Libye; elle possédait six cents chevaux, cent chameaux, autant de
dromadaires, des moutons, des chèvres, des volailles en grande
abondance. Presque toujours la moitié des cavaliers, était en maraude
pendant que l'autre moitié se reposait. Le camp devenait l'entrepôt
général des objets pillés, et c'est là que s'en faisait le partage.
L'adoption de Roquet par le cheik principal, et son talent sur le fifre,
qui, de plus en plus, émerveillait la peuplade, lui firent sur-le-champ
une situation tolérable et une vie qui n'était pas sans charme. A part
la liberté, il ne lui manquait rien. Son maître l'avait attaché au
service intérieur de sa tente, service facile, dans lequel il aidait les
femmes. Il allait puiser de l'eau à la source; pilait le doura, espèce
de millet avec lequel les Arabes confectionnent leur pain; préparait le
pilaw de riz, battait le lait de chamelle pour le convertir en beurre.
L'ordinaire de la maison n'était pas très-somptueux; mais, à la rigueur,
il pouvait suffire. On avait du riz, des dattes, des galettes de doura,
du blé, des fèves; une fois par semaine, on tuait un mouton ou quelques
volailles. L'artiste de la soixante-neuvième possédait quelques talents
en cuisine; il les mit à la disposition de son maître et apprêta
plusieurs mets; à l'européenne. Cette expérience gastronomique fut moins
heureuse que ses tentatives musicales. Le cheik goûta peu les recettes
du jeune Français; il leur préférait son riz étuvé à la manière
asiatique. Mais le fifre eut en revanche un long succès. Chaque soir,
dans ces veillées arabes où, partagés entre la pipe et le café, les
principaux de la tribu prêtent l'oreille à leurs conteurs, l'artiste
avait constamment un rôle à jouer. C'était, un jour, une marche
brillante; l'autre jour, un adagio ou un cantabile plein de
mélancolie. En général, les auditeurs préféraient une musique lente à
une musique vive. Les airs langoureux, et même monotones, les charmaient
par-dessus tout. Pour les servir selon leur goût, le fifre de la
soixante-neuvième se mit à apprendre plusieurs de ces chants arabes que
l'on nomme des moals, et qui sont une espèce de récitatif composé de
notes plaintives. Roquet transporta ces moals sur son instrument, et il
fut dès lors un barde incomparable.
Cependant la captivité commençait à peser au troubadour des Hennadis.
Comme Achille à Scyros, il s'indignait de languir dans ce camp et d'y
partager les travaux des femmes. Le souvenir de ses frères d'armes le
poursuivait, et il ne rêvait qu'aux moyens de les rejoindre. Pour y
parvenir, il demanda d'abord au cheik la faveur d'aller en course avec
les maraudeurs de la tribu. Comme ces excursions les conduisaient vers
la lisière des terrains cultivés, il lui eût été facile de choisir alors
un moment pour s'esquiver et regagner les rives du Nil. Le cheik comprit
ce calcul et le déjoua. Le Français était trop jeune, disait-il, pour
supporter les fatigues du désert. Il ne savait pas manier la lance; il
n'était pas encore assez bon écuyer. D'ailleurs, que lui manquait-il?
N'avait-il pas du pain et des dattes, un burnous pour se couvrir, une
tente pour se reposer? Roquet avait beau insister: le cheik persistait
dans ses refus. On lui permit pourtant de monter à cheval, de s'exercer
au djérid, de courir la gazelle. Du service domestique, il pût passer
au soin de ces magnifiques poulains qu'élèvent les Arabes. C'était un
avancement; mais ce n'était pas la liberté. Quelquefois il songeait à
fuir; mais de quel côté se diriger, sans vivres, sans eau, sans aucune
connaissance des routes du désert, mobiles comme ses sables? Quand ces
pensées s'emparaient du captif, il tombait dans la tristesse et dans
l'abattement.
Une distraction imprévue lui arriva. La femme favorite du cheik, nommée
Fatmé, belle brune de vingt ans, avait remarqué depuis longtemps la
bonne mine du jeune Français. Roquet n'était point un Adonis, bien s'en
faut; mais il avait des yeux bleus, des cheveux blonds et un certain air
jovial qui n'était pas sans charme. D'ailleurs, pour une femme arabe,
c'était du fruit nouveau, et toutes les filles d'Ève se ressemblent.
Fatmé fit donc au jeune homme les premières avances avec une adresse
infinie, mais cependant de manière à ce qu'il ne put s'y méprendre. Les
tentes des Bédouins, faites d'une étoffe tissée avec du poil de chameau,
ont une vingtaine de pieds de long sur quinze de large et se trouvent,
dans le milieu, partagées par un rideau qui sépare la pièce des femmes
de celle qu'occupent les hommes. Quand Roquet était seul, Fatmé ne le
perdait pas de vue, et, grâce à une ouverture qu'elle avait eu le soin
de se ménager, ces oeillades ne pouvaient pas la compromettre. Le
Français en était l'unique, complice. Roquet était bien jeune, mais à
l'école d'un régiment et en temps de guerre l'expérience arrive vite. Il
comprit donc le manège et prévit où il pouvait aboutir. Cette
perspective l'effraya. Les Arabes ne plaisantent pas au sujet de
l'adultère: la mort des coupables expie le crime quand il est découvert.
Certes, il y avait là de quoi retenir le séducteur le plus hardi. D'un
autre côté, Fatmé était bien belle. Elle avait, pour parler la langue
des Arabes, des yeux fendus en amande comme ceux de la gazelle, des
sourcils arrondis comme un arc d'ébène, la taillé souple et droite comme
une lance, les seins pareils à une couple de grenades, la peau unie
comme de la soie, le sourire doux comme le miel. Ses ongles étaient
teints avec du henné aux reflets d'or, ses paupières avec du kohl,
noir comme la plume de corbeau. C'était, en un mot, le type idéal de la
perfection, la beauté du poète Hafiz quand il dit: «Elle est comme le
premier rayon quand il jette ses teintes roses sur le sable; elle est
comme la lune quand elle argente la plaine; son haleine est la brise qui
traverse l'oasis; ses cheveux pendent sur ses épaules comme les branches
d'un sycomore.»
Tout cela avait sa séduction, poésie à part. Notre troubadour n'y
résista pas. Que faire au milieu du désert, si l'on n'y trouve pas une
bonne fortune? Il résolut donc de se laisser aimer. Quelques mois de
séjour au milieu de la tribu lui avaient rendu la langue arabe
familière, et il put joindre au langage des yeux un idiome plus
expressif. Des aveux furent échangés; mais si la vie patriarcale du
désert avait cet avantage de mettre les amants presque toujours en
présence, elle avait cet inconvénient de ne jamais les laisser sans
témoins. Ces peuplades nomades ne partagent pas, en effet, les préjugés
des musulmans pour ce qui concerne les femmes. Elles vont dans les
camps, le visage découvert, se rendent seules au puits et à la fontaine,
pour y prendre l'eau nécessaire aux besoins domestiques. C'est la vie
biblique, conservée dans presque tous ses détails, avec ses allures
indépendantes, ses moeurs en plein air. Fatmé et Roquet se voyaient, se
parlaient à chaque instant. Elle lui avait dit vingt fois qu'elle
trouvait ses cheveux plus beaux que le safran, son teint plus charmant
que le laurier-rose; Roquet, de son côté, se mettait en frais de
galanteries orientales, et la comparait à tout ce qu'il pouvait
imaginer, de plus agréable dans la nature. Mais tout se bornait à ces;
paroles glissées à la dérobée.
Au bout de trois mois de ce manège, des deux côtés on désirait mieux;
mais là commençaient les grandes difficultés. La tribu avait plusieurs
fois changé de campement, sans qu'il s'offrît aucune occasion sûre. Le
cheik était toujours là, et pendant ses absences les femmes se
surveillaient mutuellement. La moindre faute eût été dénoncée. Enfin, à
la suite d'une expédition dans l'Égypte moyenne, les tentes furent
levées et l'on se rapprocha des oasis qui occupent le centre du désert
libyque. Un soir on vint camper auprès d'un abreuvoir connu dans le
désert sous le nom de Birket-Men. L'eau que l'on y recueillait
découlait des suintements d'une grotte, et il fallait; avant que les
jarres fussent pleines, attendre qu'elle eût tombé goutte à goutte.
Fatmé résolut de profiter de la circonstance. Pendant que le Français
allait faire le provision pour les chevaux, elle quitta la tente avec
ses gargoulettes en grès destinées au service du ménage. Ainsi ils
purent demeurer seuls pendant un quart, d'heure sans éveiller les
soupçons. Fatmé ne perdit pas de temps. Sa figure, ordinairement calme
et douce, s'anima d'une résolution extraordinaire et d'un éclat
singulier:
--Chrétien, lui dit-elle, m'aimes-tu?
Le jeune homme allait se lancer dans les métaphores orientales et
recommencer les comparaisons d'usage avec la lune et le soleil, quand
elle l'arrêta:
--M'aimes-tu, chrétien, jusqu'à mourir pour moi et avec moi?
La proposition parut brusque à notre héros: cependant il n'hésita pas.
--Oui, Fatmé, je t'aime! Que cette eau soit ma dernière boisson et que
je ne revoie jamais la France, pays du riquiqui, si je mens.
La belle Arabe ne comprit pas parfaitement l'allusion, mais son
troubadour acceptait la partie; cela lui suffisait:
--Nous n'avons pas de temps à perdre, dit-elle. Tu es libre, les cavales
t'obéissent. Quand l'étoile du sud sera sur nos têtes, sors de la tente,
prends les deux meilleures montures du maître, Gazai et Melek; va te
cacher derrière ce tertre et joue un moal sur ton instrument. Fatmé
sait ce qui lui reste à faire.
--Ça me va, arabesque chérie, ça me va. Tu consens donc à me suivre dans
la soixante-neuvième demi-brigade qui est ma patrie?
--Une fois libres, Dieu nous guidera. Fais-ce que je t'ai dit, chrétien.
--C'est juste, laissons quelque chose au commandement du Père éternel.
Ils se séparèrent. Quand la nuit fut venue, Roquet sortit du camp sans
affectation et en jouant quelques airs sur son fifre. Melek et Gazai,
deux cavales de race, avaient été attirées un peu à l'écart. Quand
l'étoile du sud fut parvenue, à son zénith, il exécuta l'air convenu. Il
était minuit. Fatmé se releva de dessus le tapis qui formait sa couche,
et jeta un regard inquiet autour d'elle. Avec la souplesse d'un lézard,
elle parvient à Se glisser sous la toile de la tente, continue à ramper
pendant quelque temps sur le sable, puis, légère comme une biche,
disparut derrière la masse des rochers. Personne ne l'avait aperçue.
Elle rejoignit son complice; ils montèrent à cheval et s'éloignèrent en
silence.
III
L'oasis.
En s'éloignant du camp le couple fugitif dut prendre quelques
précautions. Rien n'est plus sonore que le désert: aucun de ses bruits
n'échappe à l'oreille des Arabes. Il fallut donc mettre les juments au
pas; et ces bêtes intelligentes, comme pour s'associer à la pensée de
leurs cavaliers, semblaient poser à peine leurs pieds; sur le sable. Au
bout d'une heure seulement elles prirent le galop et les emportèrent à
travers ces solitudes avec la rapidité de la brise.
Fatmé avait une grande expérience de la vie nomade; elle connaissait
mieux que son complice les dangers qu'ils allaient courir. Le plus grand
était celui de laisser après eux une trace qui les dénonçât et qui pût
servir à les poursuivre. Le sabot de leurs montures imprimait ses
vestiges sur le sol, et quoique à dessein ils prissent de loin en loin
leur direction dans des chemins rocailleux, certains indices les
trahissaient toujours. Fatmé avait son plan: elle voulait, on saura
pourquoi, se rapprocher de la grande oasis et gagner Syouah, qui n'était
qu'à deux journées de marche; elle courut d'abord tout droit à l'est,
comme si elle eût voulu rejoindre le Nil. Habituée depuis six ans à
voyager dans ces espaces, elle n'ignorait rien des ressources qu'elles
offrent, des difficultés sans nombre dont ils sont semés. Les puits, les
lieux de halte, les moyens de reconnaissance soit de nuit, soit de jour,
lui étaient familiers. Aussi n'hésitait-elle pas dans son itinéraire; et
si sa mémoire s'était trouvée en défaut, l'instinct seul des montures
eût suffi pour retrouver la route.
Quand le jour se fit ils avaient déjà franchi quinze lieues, mais cet
intervalle ne la rassurait pas. Elle comprenait que dans le camp arabe
son évasion venait d'être découverte et qu'on était déjà sur ses traces.
La journée promettait d'être lourde: le soleil s'était levé au milieu de
vapeurs qui le dépouillaient de ses rayons et lui donnaient l'aspect
d'un disque rougi au feu. La respiration devenait difficile, les poumons
respiraient un air embrasé. Fatmé, habituée à cette température ardente,
n'en paraissait pas incommodée, mais son compagnon de route commençait à
se plaindre. Six heures de galop avaient ébranlé son moral et fortement
secoué toute son économie. Il ne pouvait se défendre de penser que sa
bonne fortune n'avait rien de bien riant dans ses débuts. Ce galop sans
trêve, contre un vent chaud qui lui fouettait le visage eut bientôt
épuisé ses forces; et quand midi arriva il demanda grâce, haletant et à
demi mort. Une halte exposait le couple à un danger certain; mais l'état
où se trouvait le Français la rendait nécessaire. On s'arrêta sous un
palmier pendant une heure, et quelques vivres ranimèrent le pauvre fifre
qui jouait un singulier rôle. La course recommença ensuite jusqu'au soir
dans une atmosphère de plus en plus étouffée et au milieu de tourbillons
de poussière, précurseurs du vent du désert. Quand le soleil se coucha,
le simoun commençait à envoyer ses rafales, et le frissonnement des
sables donnait à ces solitudes l'aspect d'une mer émue. Fatmé observait
avec inquiétude ces symptômes qui lui étaient familiers, et en même
temps elle tenait son oeil attaché sur les profondeurs de l'horizon.
Tout à coup un cri sourd s'échappe de sa poitrine:
En effet, dans les clartés du couchant, on pouvait distinguer le bois de
leurs piques; ils étaient lancés à toute bride, ils arrivaient. Le seul
espoir de Fatmé était que l'un des deux périls annulât l'autre. Le
simoun devenait à chaque instant plus impétueux, et par intervalles le
sable se soulevait de manière à former un rideau entre les fugitifs et
les hommes envoyés à leur poursuite. Ces tourbillons duraient longtemps
et effaçaient toutes les empreintes laissées sur le sol. Cette
circonstance décida la belle Arabe à user, comme dernier moyen, d'un
stratagème singulier. Au moment où ses ennemis croyaient la tenir et
fondaient déjà sur elle avec des cris sauvages, elle profita d'un de ces
nuages de poussière pour changer brusquement de direction. Rebroussant
chemin, elle passa à côté des Arabes, presque à les toucher, sans qu'au
milieu du bruit de la tempête et du soulèvement des sables ils pussent
l'apercevoir; puis elle disparut derrière un mamelon, tandis, que les
émissaires du cheik continuaient leur poursuite dans le même sens et
couraient toujours vers le Nil. La manoeuvre avait réussi: les chasseurs
avaient perdu la piste. Dans ce mouvement, le rôle de notre héros avait
été purement passif; il s'était abandonné machinalement à l'impulsion
donnée par l'amazone; son admirable monture avait fait le reste; ils
étaient sauvés.
La tempête durait encore; mais c'était son dernier effort. Au bout de
deux heures d'une course combinée de manière à tromper toutes les
recherches, le vent s'était calmé, le ciel avait repris un peu de
sérénité. Ainsi ce simoun, ordinairement si malfaisant, n'avait eu
cette fois qu'une influence heureuse. Avec un air plus frais. Roquet
avait recouvré le sentiment de ses forces et de sa dignité. Tant
qu'avait duré le péril, il avait eu le plus petit rôle: il n'enlevait
pas sa belle, c'était elle qui l'enlevait. Cette situation l'humiliait,
il voulut s'en relever en faisant le galant auprès de sa conquête. Fatmé
résista d'abord; mais l'artiste se montra pressant, tendre, persuasif;
elle capitula. A la nuit close, un petit vallon se trouva sur leur
route: ils s'y arrêtèrent pour le repas du soir. Un palmier fournit les
dattes, une source la provision d'eau. Quelques brins d'herbe
qu'entretenait l'humidité du terrain formaient une pelouse naturelle.
Roquet y reposa voluptueusement ses membres brisés par une course
forcée.
L'atmosphère avait recouvré sa limpidité, les étoiles baignaient dans un
ciel transparent. De ce bouleversement météorologique, il n'était resté
qu'une grande tiédeur dans l'air, et des odeurs pénétrantes,
transportées des lieux cultivés jusque dans ces solitudes arides. Tout
invitait les sens à la langueur, et le souvenir des dangers courus
ajoutait encore au plaisir de se sentir libre. Loin de l'oeil du maître,
les femmes de l'Orient ont peu de scrupules; elles saisissent les
occasions au vol. De leur côté, les Français conduisent rondement les
choses, et ne remettent rien au lendemain. Le couple fugitif s'oublia
donc pendant quelques heures, et cette halte dans le désert paya notre
artiste de toutes ses infortunes.
Fatmé, au milieu de cet abandon, raconta son histoire à son amant. Elle
était chrétienne. Fille du prince qui gouvernait l'oasis de Syouah, elle
s'était vu enlever à l'âge de treize ans par le cheik des Hennadis, et
depuis lors elle avait vécu dans le désert sans que son père pût savoir
ce qu'elle était, devenue. Cette vie lui était odieuse: à tout prix elle
voulait en sortir, et pourtant son esclavage avait duré huit ans. Dès
qu'elle avait vu le Français, elle avait jeté les yeux sur lui pour sa
délivrance. Elle l'aimait ainsi à un double titre. Maintenant ils
allaient regagner l'oasis, qui n'était plus qu'à une journée de
distance; et là le père, enchanté de revoir son enfant, bénirait leur
union. Les tribus de Syouah étaient nombreuses, elles pouvaient se
défendre contre tous les cavaliers hennadis. Roquet devait d'ailleurs
être le plus heureux des hommes. Il aurait des dattes et du riz à
discrétion, une belle maison, des chevaux, des troupeaux, et, à la mort
du prince, il régnerait sur les peuplades de l'oasis.
Notre héros écoutait ce récit avec une satisfaction mêlée d'orgueil. Il
lui en coûtait sans doute de renoncer à la France et à la
soixante-neuvième demi-brigade, qu'il appelait sa patrie; mais être
prince du désert, époux d'une princesse dont il avait apprécié les
charmes; avoir tout en abondance, vivres, et chevaux; passer du grade de
fifre à celui de gouvernement: tout cela formait une perspective capable
d'adoucir bien des regrets et d'opérer une diversion puissante à l'amour
du sol natal. Roquet n'y résista pas: les fumées du commandement lui
montèrent à la tête; et pour récompenser la belle Fatmé du sort qu'elle
lui faisait, il lui prodigua les métaphores orientales accompagnées de
témoignages moins équivoques de sa satisfaction. On fit des plans pour
l'avenir. Roquet voulait que ses sujets fussent heureux, et il se
promettait déjà de les constituer en république une et indivisible.
Fatmé le laissait déraisonner tout à son aise et riait comme une folle
quand elle ne le comprenait pas.
Cependant il fallait partir et profiter de quelques heures de nuit pour
se rapprocher du terme du voyage. Notre héros s'y résigna, et bientôt le
sable fut de nouveau soulevé par le galop de leurs montures. Le
lendemain la chaleur était encore vive, mais tolérable. Le vent avait
passé au nord; il tempérait les ardeurs du soleil. Malgré toute la
vitesse de la marche, ce fut seulement vers le soir qu'ils aperçurent la
forêt d'oliviers qui marque la limite de l'oasis de Syouah. On ne
saurait se faire une idée du contraste qu'offre cette verdure avec la
partie aride du désert; Les yeux fatigués, de la monotonie des
perspectives, se reposent avec douceur sur ces massifs d'arbres qui
attestent le retour de la vie végétale. Les animaux, eux-mêmes
reconnaissent de loin la brise qui traverse les archipels féconds que la
nature a semés sur cette mer de sables. A mesure que l'oasis se
rapprochait des deux fugitifs, les cimes de ses bois, se découpaient
mieux sur l'horizon et tranchaient d'une manière plus vive avec l'azur
du ciel. Roquet était dans l'enthousiasme; il se voyait roi de cet Éden
et trouvait que, vu à cette distance, son royaume avait un fort bel
aspect.
Le retour de la fille du prince ou émir de Syouah produisit dans l'oasis
une sorte de révolution. Depuis longtemps on la croyait morte. On lui
fit donc une réception magnifique, et Roquet en partagea les honneurs.
Vingt moutons furent tués, et plusieurs saluts de mousqueterie
témoignèrent de la joie publique. Quoique la poudre soit un objet rare
dans ces déserts, la tribu se piqua, d'honneur. Le vieux père de Fatmé
voulait que les choses se fissent dans toutes les règles. Quand sa fille
lui parla de ses amours avec l'artiste français et des circonstances de
leur fuite, l'émir commença par trouver que l'aventure avait été
conduite d'une manière un peu leste; mais, en père de comédie, il finit
par s'apaiser. Il était cophte, chrétien par conséquent: la religion
n'était pas un obstacle à cette alliance. Seulement il voulut que la
cérémonie nuptiale légitimât ce qu'elle n'avait pu précéder. Il fut
convenu que, dans la semaine suivante, le mariage serait célébré dans
une chapelle bâtie sur les ruines mêmes du temple de Jupiter Ammon, et
près de la source connue dans l'antiquité sons le nom de: _source du
Soleil._
Au jour désigné, toute la population de l'oasis, au nombre de deux mille
âmes, se trouvait réunie dans l'enceinte de ces ruines imposantes,
désignées dans le pays sous le nom d'_Omm-Beydah_. Une portion seulement
de l'ancien temple est encore debout; mais il est facile de reconnaître
la double enceinte qui l'enveloppait dans une étendue de trois cents
mètres. Le style du monument est égyptien, et les débris qui jonchent le
sol ont aussi ce caractère. On y rencontre des restes de chapiteaux en
forme de lotus, et plusieurs tronçons de ces colonnes à cannelures qui
abondent dans les temples de l'Égypte moyenne. Toutes les décorations
qui ornent ces décombres, sculptures, revêtements, rinceaux, frises,
entablements, peintures, l'ordre et la disposition des constructions, la
nature des matériaux, rappellent les édifices de la vallée du Nil et
accusent la même origine. Seulement le temple de Jupiter Ammon, assis
sur un plateau de calcaire coquillier, semble avoir beaucoup plus
souffert que les autres de l'action du temps. La base friable sur
laquelle il repose a compromis sa conservation. Que de souvenirs se
rattachent pourtant à son existence! C'est en marchant vers ce temple,
si célèbre alors, et au moment de s'emparer des richesses qu'il
renfermait, que l'armée de Cambyse fut dévorée tout entière par le vent
du désert et abandonnée par ses guides à la colère des dieux. C'est dans
ce temple qu'Alexandre vint en personne faire constater sa généalogie et
arracher aux prêtres du lieu la déclaration solennelle qu'il était fils
de Jupiter. Roquet allait figurer dans la même enceinte, à la suite
d'Alexandre et de Cambyse, sans avoir ni l'ambition de l'un ni la
cupidité de l'autre. Son histoire devait aussi faire moins de bruit que
la leur.
Quand il parut avec sa brune fiancée, des cris de joie s'élevèrent de
toutes parts. Roquet était naturellement bon prince: il répondit de son
mieux aux effusions de ses sujets. L'émir était vieux: son gendre devait
naturellement lui succéder, et le fifre, français préludait à son
pouvoir futur. Quelques ablutions avec l'eau de la source du Soleil
servirent de prélude à la cérémonie. Elle fut achevée dans la chapelle,
où officia, d'après le rite local, un prêtre cophte à demi aveugle. Un
voile jeté sur la tête des deux époux marqua le moment de leur union,
qui fut célébrée par de nouveaux cris. Un repas, aussi somptueux que le
permettaient les ressources de la localité, acheva de donner à la fête
le caractère le plus brillant elle plus inouï. Le pilaw de riz fut
prodigué; des distributions gratuites de dattes répandirent l'abondance
dans toute la population, et Roquet monta ce jour-là sur un trône
entouré de l'affection unanime. Il réservait cependant une surprise à
ses sujets. Quand le soir fut venu et que l'ombre eut répandu quelque
fraîcheur, il demanda le silence à la foule, tira son fifre de sa poche
et se mit à exécuter une composition musicale tempérée par des mélodies
expressives. Il faut renoncer à décrire l'effet produit par le magique
instrument; l'enthousiasme était au comble, l'ivresse n'eut plus de
bornes. Séance tenante, le vieil émir abdiqua en faveur de son fils
d'adoption, et l'artiste put s'intituler Roquet Ier, prince de l'oasis
de Syouah.
Fatmé et lui régnèrent dès lors, et non sans gloire. Il fallut d'abord
se défendre contre la tribu des Hennadis, qui voulait tirer vengeance du
rapt fait à son cheik. Syouah, heureusement, est une ville fortifiée.
Située sur un rocher conique, elle est en outre, fermée par un mur de
cinquante pieds de hauteur dans lequel, douze portes ont été pratiquées.
Pour des troupes pourvues d'artillerie, ce n'était sans doute pas là un
obstacle; contre les cavaliers du désert ce rempart suffit. Les Hennadis
vinrent chevaucher autour de Syouah en poussant leurs cris habituels;
mais quand ils virent Roquet et ses guerriers prêts à les coucher en
joue du haut de leurs parapets, ils comprirent, que le jeu avait quelque
danger et transigèrent. On parla alors d'une rançon pour Fatmé, et les
plénipotentiaires la fixèrent à dix chameaux et trente moutons. Roquet
ne voulait entendre à rien; heureusement, le vieil émir lui persuada que
ce n'était pas payer trop cher, l'avantage d'être à l'abri de toute
surprise. Le pacte fat donc conclu et l'indemnité acquittée. Il ne
restait plus aux deux époux qu'à couler des jours sans nuages.
Faut-il le dire? A peine Roquet eut-il assuré sa situation, que le mal
du pays le gagna. Souverain à Syouah, il se prit à regretter le temps où
il n'était que simple fifre dans la soixante-neuvième. L'ingrat! Sa
femme lui avait pourtant apporté en dot l'une des sept merveilles du
monde, le temple de Jupiter Ammon; il avait de paisibles sujets qu'il
conduisait au fifre, et qui ne lui demandaient pas d'autres droits; ses
greniers regorgeaient de dattes et de riz, ses jarres étaient toujours
pleines d'huile. Que demandait-il donc, cet infatigable ambitieux?
Hélas! la patrie, même au prix de la misère. Roquet avait de bons
sentiments; il chassa d'abord cette pensée. Pour se distraire, il voulut
se livrer à des réformes et donner à ses sujets une foule de libertés
politiques. Personne ne le comprit, et tout marcha comme d'habitude.
Roquet insista: il avait vu des clubs en France; il tenait à importer ce
bienfait dans l'oasis. Pour obtenir que les notables se réunissent sous
sa présidence, il attacha comme prime une ration de dattes à leur
présence dans l'assemblée. On y vint pour manger la prime; mais ce fut
tout. Battu de ce côté, notre prince-troubadour chercha d'autres
délassements. L'oasis comptait quelques jolies femmes. Comme souverain
et comme Français, Roquet crut leur devoir ses hommages. Mais là il
rencontra une lionne. Fatmé était jalouse, et le moindre soupçon
d'infidélité amenait des tempêtes dans le ménage. Pendant quelques
années, notre héros prit patience; mais de jour en jour, l'oasis, sa
femme, sa royauté, l'ordinaire des dattes et du riz lui pesaient
davantage. Enfin l'explosion eut lieu:
--Ah! c'est de ça qu'il retourne, se dit-il un matin. Je veux rendre mes
sujets libres, et ils préfèrent demeurer de vils esclaves. Je veux
inculquer à mes sujettes les principes de la galanterie française, et
mon démon de femme s'avise de trouver cela mauvais. Au diable la patrie
des chameaux et des dromadaires; j'en ai suffisamment. Un peu qu'un
fifre de mon talent se laissera mettre en disponibilité! Roquer, mon
ami, il est temps de quitter ce pays de crocodiles! La France
l'appelle, mon garçon, la belle France, pays des arts et du riquiqui. En
marche et vivement!
Vers les derniers jours de juillet 1801, la garnison du Caire, à la
suite de la capitulation signée entre le général Belliard et le général
anglais Hutchinson, se disposait à s'embarquer sur le Nil. Des bâtiments
attendaient ces troupes dans la rade d'Aboukir, pour les transporter en
France. Après une lutte héroïque, attaqués d'un côté par une armée
d'Anglo-Cipayes, de l'autre par des flots de cavalerie turque conduite
par le grand vizir, décimés par une peste affreuse, sans communication
avec Menou, qui occupait Alexandrie, les Français avaient du cesser une
lutte inégale et inutile, pour accepter les conditions honorables qui
leur étaient offertes.
Cependant la tristesse régnait dans les rangs, et un morne silence
présidait à cette évacuation. La soixante-neuvième, commandée par le
général. Lagrange, était au nombre des troupes capitulées, et des
bateaux amarrés le long des berges de Boulaq étaient préparés pour la
recevoir. Le premier bataillon venait de s'ébranler, et le corps de
musique effectuait le même mouvement, quand on vit accourir, à fond de
train, un cavalier vêtu d'un bournous, et que ses traits bronzés firent
prendre pour un Arabe. Arrivé devant le bataillon, il arrêta court,
descendit de cheval, tira un fifre de sa poche, et se mit à exécuter la
marche des Tartares.
Allons, mes belles,
Allons, mes belles, suivez-nous.
--Tiens, c'est le fifre Roquet! s'écria le chef de musique.
On l'entoura, on lui fit raconter ses aventures. Pendant plusieurs
jours, ce fut la distraction de la demi-brigade. Cependant Roquet ne
perdait pas son affaire de vue. Il se fit réintégrer dans son poste de
premier fifre et demanda que, sur ses états de service, on justifiât ses
trente mois d'absence par ces mots; En congé dans le désert.
FIN.












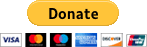






Comments